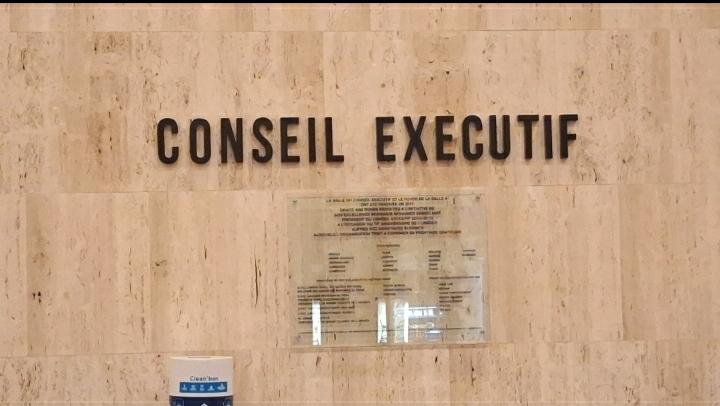Le 6 octobre 2025 restera gravé dans l’histoire diplomatique congolaise. Lors de la 222ᵉ session du Conseil exécutif de l’UNESCO, la candidature de Firmin Édouard Matoko pour le poste de Directeur général a été sévèrement sanctionnée : 55 voix pour l’Égypte, contre seulement 2 pour le Congo. Un écart impressionnant qui relance le débat sur l’efficacité de la diplomatie congolaise, ses alliances africaines, et sa capacité à émerger dans les instances multilatérales.
Le contexte et les enjeux ont révélé un scrutin aux allures de test pour le pays. Le vote au Conseil exécutif, composé de 58 membres, désignait le candidat à soumettre à l’Assemblée générale de l’UNESCO (194 États membres) pour la validation finale du mandat 2025–2029.
Cette élection intervient dans un contexte de retrait américain prévu de l’UNESCO, ce qui affaiblit structurellement l’organisation et l’oblige à diversifier ses financements. Selon Le Monde, la candidature de Khaled El-Enany bénéficiait d’un soutien stratégique : l’Union africaine, la Ligue arabe, ainsi que la France qui l’ont appuyé. Quant à fFirmn Edouard Matoko, son parcours long au sein de l’UNESCO (Assistant Directeur général pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures de 2017 à 2025) lui vaut respect et légitimité au plan institutionnel. Pendant la campagne, il a insisté sur l’intégration des priorités africaines aux stratégies globales de l’UNESCO.
Défaite spectaculaire : question de diplomatie ou d’absence de stratégie ?
Cet écart colossal pose plusieurs interrogations :
- La diplomatie congolaise a-t-elle failli ? Malgré une délégation importante (menée par Jean-Claude Gakosso) et un appui visible du gouvernement, le Congo n’a pas su convertir ce soutien en voix. Certains analystes y voient un isolement diplomatique — une incapacité à fédérer une coalition africaine crédible, voire une stratégie de lobbying trop tardive ou insuffisante.

Salle X de l’Unesco pendant le débat plenier@MAE/Congo
Le manque d’alliances africaines est-il révélateur ? Dans un contexte où l’Afrique avait déjà des candidatures concurrentes à l’UNESCO ou d’autres organisations, le groupe semblait divisé. Le décès antérieur d’Amadou Mahtar Mbow, premier Africain à avoir dirigé l’UNESCO (1974–1987), symbolise peut-être la fin d’une époque de voix unifiées africaines dans les grandes instances.

- La communication et le timing ont-ils fait défaut ? Le candidat congolais a été critiqué pour son arrivée tardive dans la course, et certains estiment que la stratégie de communication ou de lobbying n’a pas été à la hauteur de celle d’El-Enany très actif sur les réseaux diplomatiques.
- Un échec isolé ou symptomatique ? Ce revers rappelle celui de Henri Lopes, dont la candidature à la tête de l’OIF avait également stagné. Deux défaites importantes en quelques années pour le Congo laissent penser à un défi structurel dans la manière de porter ses candidats sur la scène internationale.
Silence officiel, message résilient
Depuis l’annonce des résultats, pas de réponse publique du gouvernement congolais. Quant à Firmin Matoko, il s’est contenté d’un message de remerciement sobre sur Facebook, saluant le soutien reçu sans commenter le score.

Ce revers ne serait pas pour autant fatal — il pourrait servir de catalyseur vers une diplomatie repensée. En effet, le Congo devra repenser ses alliances africaines, œuvrer pour des coalitions durables dans les organisations internationales. Il est urgent de professionnaliser la diplomatie de candidature : renforcer les réseaux, anticiper les alliances, mobiliser la communication. La prochaine échéance sera cruciale : le gouvernement devra tirer les leçons de cet échec pour mieux préparer et positionner ses candidats.

En guise de conclusion, la candidature de Firmin Édouard Matoko restera comme un geste audacieux, empreint de conviction. Son échec est sévère, mais il révèle surtout une vérité politique : si le Congo veut peser dans les grandes instances du multilatéralisme, il doit forger des stratégies diplomatiques solides et redéfinir son approche sur la scène internationale.
Carmen Féviliyé